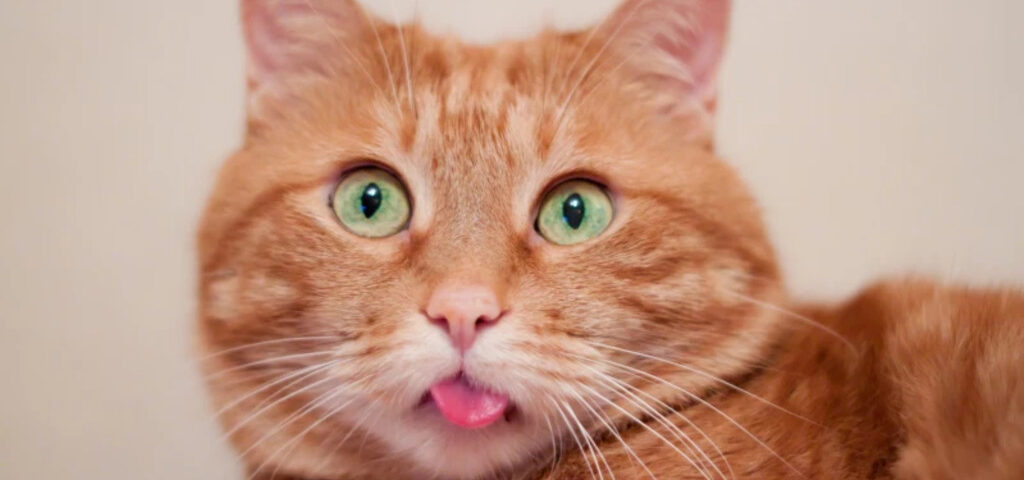Ils trônent fièrement sur les rebords de fenêtres, inspirent les peintres et font fondre Internet avec leurs airs de petits félins en feu : les chats roux ne passent jamais inaperçus. Mais pourquoi donc certains chats arborent-ils cette robe flamboyante alors que d’autres restent gris, noirs ou tigrés ? Après des siècles de mystère, des chercheurs viennent de percer l’énigme. Et la réponse est bien plus surprenante qu’on aurait pu l’imaginer.
Un mystère génétique enfin résolu
Depuis le XIIᵉ siècle, les représentations de chats roux existent dans l’art et la littérature, mais leur secret restait enfoui dans l’ADN. Des équipes de l’Université Stanford et de l’Université Kyushu, au Japon, ont enfin identifié le variant responsable : une mutation spécifique liée au chromosome X.
Concrètement, les scientifiques ont analysé 51 variantes génétiques communes aux mâles roux (qui ne possèdent qu’un seul chromosome X). Après un travail de fourmi, ils ont isolé une seule mutation clé. Celle-ci agit comme un interrupteur : au lieu de produire des pigments noirs ou bruns, elle entraîne la fabrication de teintes plus claires, qui se traduisent par ce pelage orange si reconnaissable.
Le rôle inattendu d’un gène méconnu
Le plus étonnant ? Ce changement est lié à un gène baptisé ARHGAP36, jusque-là inconnu dans le domaine de la pigmentation. Normalement actif dans les tissus neuroendocriniens, il n’avait aucun rapport connu avec la couleur du pelage. Pourtant, chez les chats roux, ce gène est anormalement stimulé, forçant les cellules pigmentaires – les mélanocytes – à produire du orange plutôt que du noir.
« Identifier ce gène était un rêve de longue date », a confié le professeur Hiroyuki Sasaki, généticien et… grand amateur de chats.
Heureusement pour ces félins, la mutation se situe dans une zone non codante de l’ADN. Cela signifie qu’elle influence l’activité du gène sans altérer la protéine elle-même – un point crucial, puisque des changements directs dans ARHGAP36 pourraient être dangereux pour la santé du chat.

Pourquoi les femelles sont rarement entièrement rousses ?
Si vous avez déjà remarqué que la majorité des chats roux sont des mâles, ce n’est pas un hasard. Le gène de la couleur se trouvant sur le chromosome X, les femelles (XX) doivent recevoir la mutation sur leurs deux chromosomes pour être totalement rousses – une probabilité minime. Résultat : la plupart des femelles présentent plutôt des mélanges de couleurs, comme les robes écaille de tortue ou calico, avec ces fameuses taches rousses mêlées au noir et au blanc.
Ce phénomène est lié à l’inactivation aléatoire de l’un des deux chromosomes X durant le développement embryonnaire. Chaque cellule choisit son « X actif », créant ainsi des zones colorées différentes. Ce mécanisme est d’ailleurs devenu un exemple classique dans les manuels de biologie pour expliquer la génétique du sexe.

Un progrès rendu possible par la technologie
Si ce mystère n’avait pas encore été percé, c’est aussi parce que la science n’en avait pas les moyens. La cartographie du génome félin et les techniques avancées de séquençage n’ont véritablement progressé que ces dix dernières années. Comme le souligne Christopher Kaelin, chercheur principal à Stanford, ces outils modernes permettent aujourd’hui de déchiffrer des codes qui restaient auparavant inaccessibles.
Cette découverte ne fait pas que réjouir les amoureux de chats : elle offre aussi un nouveau terrain d’étude sur la génétique des couleurs, qui pourrait éclairer la biologie d’autres espèces.
Le chat roux, star intemporelle
En attendant que la science continue de dévoiler les secrets de la nature, les chats roux, eux, poursuivent leur carrière de stars. Que ce soit Garfield dans les bandes dessinées, un matou du voisinage qui s’invite à l’apéro, ou le chat roux d’une toile du Moyen Âge, ces félins flamboyants continuent d’exercer une fascination universelle.
Et désormais, lorsque vous croiserez un chat roux se prélassant au soleil, vous saurez qu’il porte en lui un gène rare et singulier, fruit d’un héritage génétique aussi mystérieux qu’élégant. En somme, un parfait mélange entre science et poésie féline.